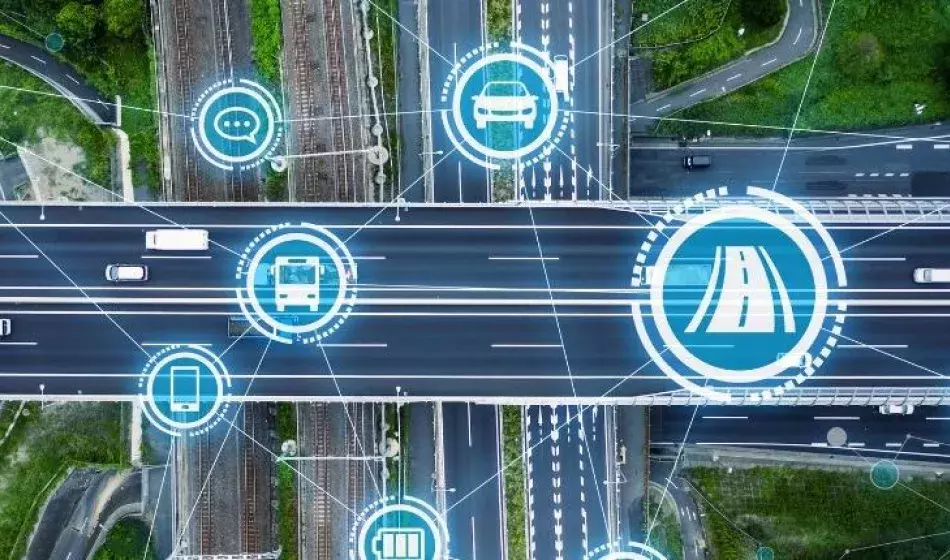Intégration des citoyens dans l’écosystème des smart cities

L'histoire nous a prouvé que les villes pourraient innover et rester en phase avec toute évolution, ou se replier et devenir vieilles et défaillantes, avec des services non adaptés aux besoins émergents de la population. Cela pourrait entraîner un ralentissement de la croissance de la ville et éventuellement une baisse à long terme. Si une communauté ne s'adapte pas au progrès via l'innovation, elle ne profite pas des avantages découlant de l'utilisation de nouvelles technologies.
L’écosystème d’une ville intelligente
D'ici 2050, la population mondiale devrait atteindre plus de neuf milliards, et 80% de cette population résidera principalement dans des villes. Aujourd'hui, les villes abritent un peu plus de la moitié de la population mondiale alors qu‘elles ne représentent que 2% de la surface terrestre et sont responsables de la consommation de 80% des ressources de la Terre. Cette tendance croissante nécessite l’adoption d’un nouveau type d’innovation caractérisé par :
- Un niveau élevé de participation des citoyens à la co-création d’applications et de services numériques dans tous les secteurs de l’économie et une forte implication dans la co-création de la société numérique.
- L’émergence de nouvelles formes de collaboration entre les gouvernements locaux, les instituts de recherche, les universités, les associations, les citoyens et les entreprises.
Ces stratégies et les « écosystèmes d'innovation » urbains qui en résultent deviennent de plus en plus pertinents étant donné l'urgence de s'attaquer aux problèmes sociaux, économiques et sociétaux.
Il s’agit de rassembler les différents acteurs qui ne sont pas habitués à travailler ensemble pour apporter des solutions innovantes et créatives qu’aucune des parties n’aurait pu réaliser seule.
Les collaborations « Smart city »
L’augmentation des Smart Cities permet de créer des partenariats public-privé donnant naissance à de nouvelles opportunités, réduction des coûts et un accès aux connaissances et expertises. Une collaboration mutuellement bénéfique :
- Une bouée de sauvetage pour les startups qui ont besoin du secteur public pour que leurs initiatives prennent vie,
- Les gouvernements des villes ont de plus en plus faim de données pour éclairer les approches sur tout, depuis la police, les interventions d'urgence, la gestion des déchets et les transports publics …
Les modes de fonctionnement des secteurs privé et public
La collaboration n'est pas toujours simple, et l'un des principaux obstacles au déploiement des villes intelligentes réside dans les différents modes de fonctionnement des secteurs privé et public.
Les organisations privées ont plus de flexibilité et existent pour réaliser des bénéfices, tandis que les gouvernements dépendent du financement, et les projets peuvent être abandonnés ou suspendus sans préavis si ce dernier change. Les entreprises privées gardent généralement leurs activités d'achat confidentielles, tandis que les organisations publiques doivent être transparentes sur la façon dont l'argent est dépensé.
Les pressions financières et temporelles qui pèsent sur les municipalités pour qu'elles réalisent des projets de ville intelligente signifient qu'elles peuvent avoir besoin d'aide et de ressources de tiers et ne sont pas en mesure de tout faire elles-mêmes pour respecter les délais et le budget.
Pour cette raison, certains encouragent l'utilisation des technologies open source pour faciliter la collaboration et fournir des données à travers le conseil dans un format standardisé. Mais les entreprises technologiques peuvent avoir du mal à travailler avec l'open source.
Startups vs Entreprises
Les grandes entreprises ont des cycles d’innovation plus lents, il est donc plus difficile pour elles de mener ce genre d’expériences itératives rapides attendues dans les démarches Smart City.
A l’inverse, les startups par leur fraicheur et vivacité ont cette capacité de réactivité. Cela signifie que les jeunes entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour faire avancer le secteur.
Depuis qu'elles ont cerné le pouvoir que recèlent les données pour mieux comprendre leur territoire et améliorer leurs services, les villes cherchent à en obtenir toujours plus. Elles ont d'abord commencé à s'intéresser à celles émanant de leurs propres services. Puis à celles des entreprises délégataires de service public, notamment dans les transports (Kéolis, RATP, Transdev…), l'énergie (Engie, EDF) ou encore le traitement de l'eau et des déchets (Suez, Veolia).
Les collectivités rêvent de mettre ces données en open data, mais les entreprises ne veulent pas en entendre parler. "Ce sont des données qui ont un caractère concurrentiel et commercial, comme les analyses de flux, d'origine, de destination et de cheminement", précise Jean-Philippe Clément, administrateur général des données de la Ville de Paris. La discussion pourrait s'arrêter là. Mais en réalité, privé et public sont prêts à des compromis. "Il vaut mieux être pragmatique et commencer par quelques jeux de données simples. Les entreprises sont prêtes à dealer au cas par cas des données plus riches".
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

Nous accompagnons la transformation de vos métiers : maîtrise de la Data, industrialisation des processus, dématérialisation et alignement des SI avec les nouvelles exigences réglementaires.