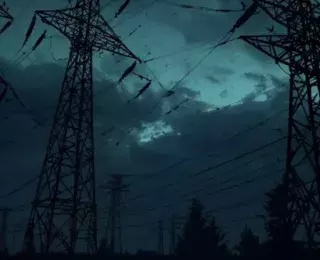Transition numérique : quels impacts écologiques ?

Dans l’imaginaire collectif, toutes les innovations technologiques smart sont green : smart Building, smart car, smart TV … L’utilisation de ces nouvelles technologies est-elle réellement respectueuse de l’environnement ?
Certaines innovations technologiques amènent des économies d’énergie, d’autres ont un bilan environnemental négatif mais amènent de grandes avancées dans leur domaine de compétence. Il s’agit donc de faire part de discernement : ne pas rejeter systématiquement toute nouvelle technologie, ni en accepter les yeux fermés par progressisme idéologique.
L’analyse de pertinence énergétique des technologies connectés
Le groupe de travail du Shift Project, think tank œuvrant en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone, met à disposition des entreprises, gratuitement, un modèle mathématique permettant de vérifier la pertinence énergétique d’une technologie connectée. Il s’agit de qualifier l’augmentation ou la diminution de la consommation d’énergie permise par l’introduction de la couche connectée (en comptabilisant sa production et sa consommation en fonctionnement).
La pollution numérique correspond à toutes les formes de pollutions liées à l’utilisation des produits numériques (fabrication, transport, usage, recyclage …). Aujourd’hui les émissions de gaz à effet de serre liées aux systèmes numériques sont équivalentes à la totalité des camions qui circulent dans le monde. Ce chiffre augmente de 8 à 10% par an. Nous avons l’impression que le numérique est, par essence, illimité et immatériel, la réalité peut être plus complexe. La dématérialisation et cloud sont des dénominations trompeuses. Toutes ces innovations virtuelles fonctionnent car elles s’appuient sur toujours plus d’équipements informatiques physiques. C’est en réalité une matérialisation.
Les gains de consommation d’énergie des innovations technologiques suffisent-ils à rattraper l’inflation des usages ?
Les études d’impacts écologiques concernant les nouvelles technologies sont souvent incomplètes. Leurs complétions rigoureuses demandent plus de temps que le cycle de vie moyen du produit qu’elles analysent. Elles sont donc souvent réalisées rapidement, au risque d’être obsolètes à leur sortie. Deux principaux domaines, à fort impact, sont ignorés des études : les coûts de production et les effets rebond.
Afin qu’une nouvelle technologie soit adoptée, les études mettent souvent en avant le gain énergétique dû à son utilisation, mais ignorent les coûts de production. À titre d’exemple, un smartphone est changé en moyenne tous les 2 ans. La consommation d’énergie lors de la phase de fabrication représente à elle seule 90% de la consommation d’énergie totale de la vie du produit.
Les effets rebond sont aussi souvent mis à part des études d’impacts énergétiques. Par effet rebond, nous désignons un accroissement de la consommation provoqué par la réduction des limites qui étaient jusque-là posées à l'usage d'un bien. Pour illustration, les écrans plats ont été introduits, en remplacement des écrans à tubes cathodiques, notamment car ils consommaient moins d’énergie. Cependant, leurs simplicités de transport et d’utilisation ont contribué à multiplier leurs utilisations dans les espaces de vie (malgré un recyclage moins performant), jusqu’à même trouver une place dans les couloirs du métropolitain des mégalopoles. Cette nouvelle technologie a donc créé de nouvelles habitudes de consommation. Il en résulte donc, in fine, une augmentation des consommations énergétiques, là où nous aurions pu en espérer une diminution.
L’augmentation de la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre illustre que les usages de consommations augmentent beaucoup plus que les gains énergétiques qu’ils amènent. Le bilan énergétique des technologies doit aussi être analysé au prorata des sources d’énergie qu’elles consomment. A ce titre, rien n’a vraiment évolué depuis les années 1970. Les deux tiers de l’électricité consommée dans le monde restent d’origine fossile (charbon / gaz), et les centrales construites actuellement, dont la durée de vie avoisine les 50 ans, perpétuent ce modèle de production.
Les améliorations technologiques ne suffisent donc malheureusement pas à décarboner la société. Par conséquent, la transition numérique aujourd’hui ne contribue donc pas du tout à la préservation de l’environnement. Si l’on souhaite contenir, d'ici à 2100, le réchauffement climatique planétaire en dessous de 2 °C, le principe de sobriété semble alors inéluctable. Comment s’autolimiter collectivement sur les usages de ces technologies ?
Quelle ville du futur voulons-nous ?
Plutôt qu’une superposition de services et d’infrastructures connectées, la ville intelligente devra faire preuve de sobriété. Ce ne sont pas les choix technologiques qui doivent imposer une forme d’organisation sociale de manière insidieuse. Plutôt que d’attendre qu’ils la structurent, questionnons-nous sur nos attentes concernant la ville du futur, afin d’en tirer les conséquences sur les applications des technologies à mettre en place.
Si la trajectoire actuelle ne change pas, au lieu d’avoir des usages numériques qui facilitent la transition de certains secteurs, ils ne feront que rendre cette transition future plus complexe. Le débat ne devrait pas être sur la 5G, les objets connectés ou les voitures autonomes, mais sur les usages que nous faisons de ces technologies. Avons-nous tous besoin d’une voiture sans chauffeur ? Nous devons définir, dès à présent, les politiques d’usages des nouvelles technologies qui seront au cœur de la ville du futur.
Afin d’éviter l’obésité numérique, un moyen simple d’atteindre la sobriété énergétique est de réguler ses achats technologiques et de prioriser leurs utilisations. Limiter la pollution numérique, c’est limiter les usages. Avons-nous réellement besoin d’une montre connectée, d’un réfrigérateur connecté, d’un collier chien connecté …
L’analyse des usages que nous faisons des technologies montre d’ailleurs que la majorité de ceux-ci sont des usages de loisirs.
En conclusion, la transition numérique dessert actuellement la transition écologique principalement parce que la technique ne suffit pas à rattraper l’inflation des usages. La transition numérique est donc à repenser. Elle est à la fois un outil et un défi pour la transition écologique. En 1969, les ingénieurs de la NASA ont fait atterrir sur la lune Apollo 11, avec un ordinateur 70 000 fois moins puissant qu’un smartphone actuel. L’innovation ne consiste pas à empiler les nouvelles technologies, mais transformer les existantes et les utiliser pour construire l’avenir de notre civilisation.
Source : https://theshiftproject.org/article/deployer-la-sobriete-numerique-rapport-shift/