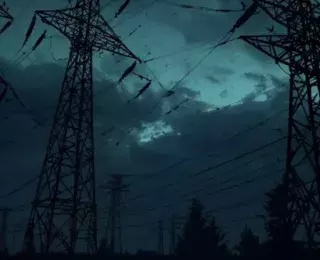Quels sont les freins législatifs à l'installation de nouvelles capacités de production et de stockage ?

Alors que la transition énergétique s'intensifie en France, le développement des capacités de production et de stockage d'énergie rencontre encore des obstacles réglementaires. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) plaide pour un cadre plus souple, intégrant pleinement le stockage aux installations bénéficiant de soutiens financiers comme le complément de rémunération.
Dans cette optique, la loi d'accélération des énergies renouvelables (EnR), adoptée en février 2023, vise à simplifier les procédures et réduire les délais administratifs. Elle met en place une planification territoriale impliquant les élus locaux et définit des zones prioritaires (dites “Zones Propices”) pour le déploiement des infrastructures énergétiques. En parallèle, le projet Potentiel cherche à fluidifier les démarches administratives pour l'ensemble des producteurs d'énergie.
Malgré ces avancées, plusieurs freins subsistent : la complexité administrative, le flou réglementaire et les réticences locales retardent considérablement la mise en œuvre des projets. Cette édition explore ces trois grands enjeux afin d'identifier les leviers permettant un déploiement plus efficace et durable des capacités de production et de stockage d'énergie.
Freins urbanistiques et sociétaux : des obstacles persistants
L’implantation des infrastructures énergétiques en France rencontre de nombreux défis liés aux réglementations d’urbanisme et à l’acceptabilité sociale. Entre restrictions environnementales, contraintes réglementaires et oppositions locales, ces freins ralentissent considérablement le développement des capacités de production et de stockage d’énergie.
Des contraintes réglementaires importantes
Une large partie du territoire est soumise à des restrictions limitant l’implantation des infrastructures énergétiques : zones naturelles protégées, servitudes militaires ou encore réglementations paysagères. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) encadrent strictement l’usage des sols, nécessitant des études d’impact approfondies qui allongent les délais et augmentent les coûts des projets. De plus, les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) imposent des exigences supplémentaires qui réduisent d’autant plus les zones exploitables. Par exemple, dans le Loiret, le projet de parc éolien de Barville-en-Gâtinais et Égry a été annulé par la cour administrative d’appel de Nantes en raison de la présence de nombreux bâtiments historiques à proximité, ce qui allait à l’encontre des réglementations locales sur la préservation du patrimoine.
Une opposition locale grandissante
Les projets éoliens et solaires font face à une contestation croissante. Impact visuel, nuisances sonores et préoccupations écologiques sont souvent à l’origine de recours juridiques, retardant certains projets de plusieurs années. Les associations locales et les riverains dénoncent parfois un manque de concertation, et des référendums ont conduit à l’abandon de projets pourtant stratégiques pour la transition énergétique. C’est le cas notamment à Louversey, dans l'Eure, où les habitants et les élus de communes voisines s'opposent à un projet de parc éolien, estimant que le projet leur est imposé sans réelle consultation.
Enjeux environnementaux et fragmentation des compétences
La protection des écosystèmes impose des mesures compensatoires coûteuses et des études environnementales rigoureuses. Par exemple, en France, ces mesures représentent en moyenne 2,1 % du budget total des projets énergétiques. De plus, la répartition des responsabilités entre l’État, les collectivités locales et les autorités environnementales complique encore davantage les procédures. La mise en place de zones d’accélération pour les infrastructures énergétiques pourrait être une solution, mais son application nécessite un consensus entre les différentes parties prenantes.
Complexité administrative et incertitudes réglementaires : des barrières persistantes
Le développement des énergies renouvelables en France est encore freiné par la lourdeur des démarches administratives et les incertitudes réglementaires. Damien Mathon, délégué général du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), souligne que ces obstacles ralentissent considérablement la croissance du secteur.
Autoconsommation collective : un cadre juridique trop rigide
L’autoconsommation collective (ACC), qui permet de produire et partager de l’électricité à l'échelle locale, se heurte à des restrictions importantes. Le périmètre dérogatoire limite son déploiement aux zones éligibles, excluant souvent les zones urbaines et périurbaines. Par ailleurs, la réglementation impose aux producteurs de se déclarer comme fournisseurs d'énergie, complexifiant le processus. Une harmonisation du cadre juridique et fiscal, ainsi qu'une exonération d’accise pour les consommateurs, sont demandées pour soutenir ces initiatives.
Projets éoliens : le poids des recours juridiques
Ce phénomène, déjà identifié parmi les freins sociétaux, prend une ampleur préoccupante dans le cas des projets éoliens, souvent visés par une série de recours juridiques. Ces démarches, parfois abusives, retardent voire bloquent les projets, augmentant les coûts et les délais. Ce phénomène de "harcèlement juridique éolien" génère une incertitude pour les investisseurs et complique la mise en œuvre des infrastructures. Certains acteurs du secteur appellent à des réformes pour limiter ces pratiques tout en garantissant les droits des citoyens.
Le stockage de l'énergie : un cadre réglementaire à clarifier
Le stockage de l'énergie est essentiel pour assurer la stabilité du réseau face à l'intermittence des énergies renouvelables. Pourtant, son développement reste freiné par un cadre réglementaire insuffisant et un manque de mécanismes de soutien financier. Si certaines installations hybrides (photovoltaïque + stockage) bénéficient d'un complément de rémunération, une clarification est nécessaire pour intégrer pleinement le stockage dans toutes les filières énergétiques. Cette évolution est cruciale pour garantir l'efficacité des systèmes de production d'énergie renouvelable.
Freins à l'Investissement : une réglementation tarifaire complexe et instable
Au-delà des obstacles administratifs, la complexité de la réglementation tarifaire et le manque de soutien freinent l’investissement dans la production et le stockage de l’énergie en France.
Un Soutien insuffisant pour le stockage d’énergie
Contrairement aux Zones Non Interconnectées (ZNI), la France métropolitaine ne dispose pas de dispositifs spécifiques pour encourager le stockage d’énergie. Les acteurs du secteur appellent à la mise en place de mécanismes de soutien, notamment pour les particuliers. Parmi les solutions envisagées : la rémunération des installations hybrides, combinant production et stockage, qui pourrait accélérer l’adoption de cette technologie clé pour la transition énergétique.
Une réglementation tarifaire en évolution
Actuellement, les installations bénéficiant d’une obligation d’achat ne peuvent intégrer de stockage, ce qui limite leur flexibilité. La CRE recommande d’étendre le complément de rémunération aux dispositifs de stockage pour toutes les filières renouvelables.
Cependant, la réglementation tarifaire reste un obstacle majeur. L’arrêté du 6 octobre 2021, relatif aux contrats d’achat pour les installations de moins de 100 kW, est jugé trop complexe, en raison de calculs techniques et de fréquentes modifications. Cette instabilité décourage les investisseurs. De plus, les ajustements trimestriels des tarifs d’achat, pouvant entraîner des baisses allant jusqu’à 1,25 %, créent une incertitude financière. Un passage à un ajustement annuel offrirait plus de visibilité et favoriserait les investissements.
Lever les freins pour accélérer la transition énergétique
Si la transition énergétique est une priorité en France, elle se heurte encore à de nombreux obstacles tels que la complexité administrative, le manque de stabilité réglementaire et les freins urbanistiques. Malgré des avancées législatives, comme la loi d’accélération des énergies renouvelables, les investisseurs et acteurs du secteur font face à des incertitudes qui limitent les projets à grande échelle.
L’acceptabilité sociale et les contraintes environnementales ajoutent une autre dimension aux défis à relever. Trouver un équilibre entre préservation des paysages, adhésion des populations locales et développement énergétique est indispensable pour assurer une transition fluide et durable.
Des évolutions réglementaires sont attendues pour simplifier les procédures, sécuriser les investissements et favoriser le stockage de l’énergie. Une meilleure concertation entre l’État, les collectivités et les citoyens sera essentielle pour lever ces freins. L’avenir de la transition énergétique dépendra de la capacité des décideurs à adapter les cadres législatifs et à renforcer les incitations, afin d’accélérer la mise en place de solutions durables et résilientes.
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

Dans un contexte de transformation énergétique et réglementaire, les acteurs du secteur font face à de nombreux bouleversements, l’occasion de réinventer les modèles du secteur. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations numériques et dans leurs problématiques métiers pour en faire des leviers de performance, tout en alignant innovation et réalité opérationnelle.

Forts de nos multiples expériences, nous aidons les acteurs du secteur des Énergies et des Utilities à déployer des plans d’action concrets - refonte de SI, nouveaux services, business models innovants. En France comme en Belgique, notre expertise allie audace et pragmatisme pour des résultats mesurables.