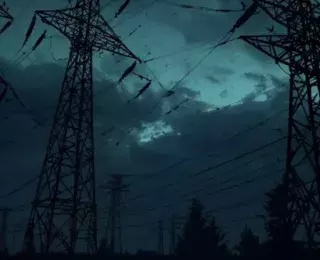Impact de l'IA sur la consommation énergétique
L’intelligence artificielle s’impose comme un moteur d’efficacité dans nos vies quotidiennes, promettant gain de temps et automatisation. Mais derrière son apparente légèreté se cache une réalité énergétique lourde : data centers ultra-puissants, consommation électrique colossale, extraction de ressources rares. Alors que la transition écologique impose sobriété et réduction des usages, l’essor fulgurant de l’IA soulève une question essentielle : comment concilier développement technologique et impératifs climatiques ?
Développement de l'IA : une bombe numérique en plein paradoxe avec la sobriété énergétique
On en parle partout. Dans les publicités, les articles, les conférences : l’intelligence artificielle serait la grande révolution de notre époque.
Longtemps cantonnée aux laboratoires et aux romans futuristes, elle s’invite désormais dans nos outils du quotidien : Copilot pour les outils de la suite Microsoft Office , Gemini chez Google, Apple Intelligence sur nos smartphones. L’IA n’est plus une promesse lointaine, elle est déjà là. Discrète, rapide, utile.
Elle résume nos e-mails, prépare nos présentations, traduit en temps réel, génère des visuels pour nos posts LinkedIn, propose des idées pour nos projets — et parfois même des diagnostics médicaux. Ce qu’elle propose, en somme, c’est du temps gagné, de l’efficacité, du confort. Pour beaucoup, c’est même un soulagement : moins de charge mentale, moins de tâches répétitives.
Et il faut bien le reconnaître : on a envie d’y croire.
À cette intelligence fluide et disponible en quelques clics. On nous la présente comme un outil du progrès, plus rapide que l’humain, et toujours à son service. Une forme d’automatisation douce, qui ne se voit pas mais qui transforme déjà nos manières de travailler, de chercher, d’apprendre et de produire.
Mais ce confort numérique a un prix. Il est bien plus lourd que ce qu’on imagine. Car derrière les interfaces fluides et les assistants bienveillants, l’IA carbure à l’électricité comme une Formule 1 sur un circuit sans fin.
Un gouffre énergétique masqué par ses atouts technologiques
D’un côté, l’intelligence artificielle joue un rôle croissant dans la transition énergétique et plus particulièrement dans la croissance des énergies renouvelables :
Elle permet le développement de smart grids, capables d’ajuster automatiquement la distribution d’énergie selon les besoins réels, réduisant ainsi les pertes et renforçant la fiabilité des réseaux. Grâce à la maintenance prédictive, l’IA anticipe les défaillances d’équipements, limitant les interruptions coûteuses. Elle optimise aussi la production en analysant les données en temps réel pour répondre aux pics de consommation. À titre d'exemple, nous pouvons citer l’outil CartoLine BT expérimenté par Enedis ainsi que les innovations renforcées par l’IA mises en place par TotalEnergies.
Enfin, son intégration dans les systèmes de gestion permet une automatisation poussée, rendant les infrastructures plus efficaces et moins dépendantes d’interventions humaines. Autant de leviers qui, bien exploités, feraient de l’IA un outil au service de la planète - mais cette image flatteuse ne tient pas longtemps face à la réalité.
Dans les faits, les usages de l’IA les plus répandus aujourd’hui n’ont rien d’écologique : entre les effets de mode qui varient toutes les semaines comme les visuels façon Ghibli, les kits de survie ou starter pack, ou encore les réponses automatisées à des questions anodines… Loin des promesses de durabilité, on assiste surtout à une explosion d’applications futiles, massivement énergivores, qui annihilent l’impact bénéfique que pourrait avoir l’IA.
Derrière l’apparente fluidité d’une réponse instantanée, l’impact énergétique de l’intelligence artificielle est vertigineux. Demander à GPT-4o de rédiger un courriel de 100 mots consomme environ 0,3 Wh, ce qui équivaudrait à vider une bouteille de 50 cL.
Et les modèles les plus lourds, comme LLaMA 3.1 405B, sont d’autant plus énergivores : 55 Wh pour 400 tokens, soit l’équivalent de six heures d’une ampoule LED allumée — pour une seule requête.
Côté entraînement, les chiffres donnent le vertige. Former GPT-3 a requis 1 287 MWh, entraînant l’émission de 550 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 205 vols aller-retour Paris–New York.
En 2023, l’ensemble du secteur IA a englouti 382 TWh, soit davantage que la consommation électrique annuelle de pays entiers comme l’Italie ou l’Argentine. Face à cette demande folle, les États-Unis et la Chine ont relancé des centrales à charbon et des réacteurs nucléaires pour faire tourner leurs data centers.
Une énergie dite “propre” qui, poussée à l’extrême, commence à perdre tout sens.
Et ce n’est pas tout. Chaque modèle génère aussi des tonnes de déchets électroniques et engloutit des centaines de milliers de litres d’eau potable.
À titre d’exemple, GPT-3 aurait évaporé à lui seul 700 000 litres d’eau douce dans les datacenters de Microsoft pour les refroidir.
Au vu de ces chiffres, ne sommes-nous pas en train d’assister à une énième opération de greenwashing, comme celles qui maquillent l’impact du fast fashion ou de l'agroalimentaire ?
Une trajectoire en contradiction frontale avec les engagements climatiques
Les prévisions sont claires : à ce rythme, l'essor de l'IA est totalement incompatible avec les objectifs énergétiques de la France.
Le pays s'est engagé à réduire sa consommation d’énergie finale de 40 % d’ici 2050 pour respecter sa trajectoire bas carbone (Stratégie Nationale Bas-Carbone – SNBC). Pourtant, selon The Shift Project, la part du numérique — dont l’IA est le moteur de croissance — pourrait à elle seule tripler sa consommation d’ici 2030, annulant en grande partie les efforts réalisés ailleurs. De plus, en février 2025, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement de 109 milliards d'euros dans l'IA, incluant la construction de nouveaux centres de données et d'infrastructures de calcul intensif.
Contrairement au mythe d'une intelligence désincarnée, l'IA est profondément matérielle. Elle repose sur des infrastructures lourdes :
Imaginez un constructeur de data center implanté à Cambrai dans les Hauts de France. Pour bâtir cette infrastructure, il lui faudra des millions de composants issus de métaux rares et terres rares (lithium, cobalt, indium, lanthane…). Pour les obtenir, il ordonnera de les extraire dans des conditions environnementales dévastatrices, à des milliers de kilomètres, où la biodiversité est sacrifiée.
Mais la construction n’est qu’un début. Une fois opérationnel, ce data center devra être refroidi nuit et jour, pour maintenir ses serveurs à température. À lui seul, il consommera 100 MWh par an, soit autant qu’une ville comme Lille.
Et le projet ne compte pas s’arrêter là : il ambitionne de créer un campus de 10 datacenters. À ce rythme, Cambrai attendrait donc une consommation annuelle de 5 TWh soit près de l’équivalent de celle des habitants de toute la ville de Marseille. Une consommation énergétique vertigineuse concentrée sur un seul site.
Derrière chaque image générée par Midjourney ou chaque requête sur ChatGPT, il y a des kilomètres de câbles, des montagnes de serveurs, et des mégawatts d'électricité.
Et les investissements massifs ne font qu'aggraver la situation. Actuellement, la France compte 315 centres de données, mais peu sont spécifiquement adaptés aux besoins de l'IA. Plusieurs investisseurs promettent de contribuer au développement de nouveaux centres de données : 30 à 50 milliards d’euros vont être investis par les Emirats arabes unis pour la construction d’un gigantesque centre de données exclusif à l’IA d’une puissance de 1 GW (soit la puissance d’un réacteur nucléaire), et 15 milliards par une entreprise américaine pour le développement de nouveaux centres d’ici 5 ans.
Les projections annoncent une multiplication par 3 de l’émission des gaz à effet de serre dus au numérique d'ici 2050 si aucune régulation sérieuse n'est mise en place. Un constat en totale contradiction avec les objectifs de sobriété. Derrière les interfaces lisses et les réponses instantanées, l’IA dévore de l’énergie. Plus elle progresse, plus elle consomme. Sans encadrement et prise d’actions pour une régulation rapide, c’est une fuite en avant technologique dans un monde qui n’aura plus les moyens de l’alimenter.
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

Dans un contexte de transformation énergétique et réglementaire, les acteurs du secteur font face à de nombreux bouleversements, l’occasion de réinventer les modèles du secteur. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations numériques et dans leurs problématiques métiers pour en faire des leviers de performance, tout en alignant innovation et réalité opérationnelle.

Forts de nos multiples expériences, nous aidons les acteurs du secteur des Énergies et des Utilities à déployer des plans d’action concrets - refonte de SI, nouveaux services, business models innovants. En France comme en Belgique, notre expertise allie audace et pragmatisme pour des résultats mesurables.