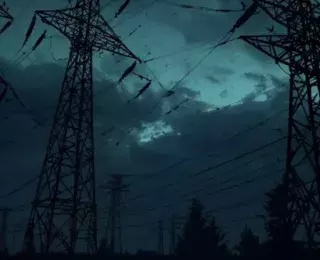Neutralité carbone : cadre et obligations
Alors que la neutralité carbone est devenue un impératif légal, les entreprises se retrouvent à la croisée des chemins entre exigences réglementaires et contraintes économiques. La pression s’intensifie, portée par des sanctions, des obligations et une surveillance accrue, mais la mise en œuvre concrète reste semée d’embûches.
Dans ce contexte, comment faire s’entendre réglementation et industriels pour assurer une transition efficace vers la neutralité carbone ?
Un carcan réglementaire plus qu’étoffé
La neutralité carbone n’est plus une option. Depuis la loi énergie-climat de 2019, qui inscrit cet objectif dans le droit français pour 2050, elle est devenue une obligation légale. Et le cadre réglementaire ne cesse de se renforcer, tant à l'échelle nationale qu'au niveau Européen.
Au niveau européen, le paquet Fit for 55 impose une réduction des émissions de -55 % d’ici 2030, via un élargissement du marché carbone (EU ETS, le système d’échange de quotas d’émission) aux bâtiments et transports routiers, et un mécanisme d’ajustement carbone afin d’éviter les délocalisations. La CSRD, qui entre en vigueur dès 2024, oblige les grandes entreprises à publier un reporting extra-financier complet, détaillant trajectoire carbone et risques climatiques. Le refus de vérification ou toute entrave au contrôle des auditeurs est lourdement sanctionné : les dirigeants risquent jusqu’à 75 000 € d’amende et 5 ans de prison, tandis que l’entreprise peut être condamnée jusqu’à 375 000 € d’amende.
À l’échelle nationale, des mesures concrètes et parfois punitives sont mises en place. Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) interdisent progressivement l’accès aux véhicules les plus polluants dans les métropoles. Le malus écologique peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les véhicules ultra-émetteurs. La rénovation énergétique devient obligatoire sous peine de sanction (interdiction de location d’une passoire thermique). Même si ces sanctions restent absorbables pour certaines grandes entreprises, elles instaurent un climat de pression réglementaire et réputationnelle permanent.
La neutralité carbone n’est plus une option ni un objectif flou pour un futur lointain. C’est une obligation légale qui s’impose à tous, des États aux entreprises en passant par les citoyens. L’urgence climatique exige une action collective et la loi en fait désormais un impératif.
Les actions peinent à avancer
Instabilité des aides
Pourtant, la mise en œuvre peine à suivre. Premier blocage : l’instabilité des aides publiques.
Les entreprises et collectivités doivent investir lourdement mais manquent de visibilité. Dans la mobilité, les ZFE imposent un renouvellement accéléré des flottes alors que les bonus écologiques et primes à la conversion changent régulièrement, rendant tout arbitrage complexe et risqué. Dans le bâtiment, les obligations de rénovation énergétique se heurtent à la volatilité des dispositifs comme MaPrimeRénov’, rendant incertaine la rentabilité des projets.
Résultat : la pression réglementaire s’intensifie, mais la stratégie d’accompagnement reste floue et fragmentée. Un cadre légal toujours plus strict, sans aide stable ni trajectoire claire, nourrit blocages et inertie. Et pendant ce temps, le temps disponible pour atteindre la neutralité carbone ne cesse de se réduire.
Industriels qui n’investissent pas, faute de visibilité sur les prix de l’énergie.
Au-delà de l’instabilité des aides, un autre frein majeur se pose : l’incertitude sur les prix de l’énergie. Pour les entreprises énergivores comme les aciéristes, cimentiers, métallurgistes ou encore producteurs de béton, la décarbonation passe avant tout par la réduction de leur dépendance au gaz et au charbon. Ces acteurs représentent une part essentielle des émissions industrielles françaises, mais ils sont aussi un pilier de notre économie. Mais si l’incertitude sur les coûts constitue un obstacle pour certaines TPE/PME industrielles fragiles, elle sert aussi d’argument commode pour les grands groupes. Ceux-ci n’hésitent pas à consacrer des milliards à des opérations financières (rachats d’actions, dividendes) tout en freinant leurs investissements dans des procédés bas-carbone. Malgré tout, sans un signal prix stable et des garanties claires, la France risque de voir ces industries reporter ou délocaliser leurs projets de transformation, au détriment de sa souveraineté et de ses objectifs climatiques.
La France doit mettre en place un pilotage à la hauteur pour pouvoir l’atteinte des objectifs
Pour lever ces blocages, la France doit mettre en place un pilotage à la hauteur de ses ambitions climatiques. Cela implique avant tout une stabilité réglementaire : des feuilles de route sectorielles précises, une planification écologique crédible et un pilotage pluriannuel permettant aux entreprises de programmer leurs investissements sur le long terme.
Il s’agit également de mobiliser pleinement les contrats d’achat d’électricité de long terme (PPA), encore trop peu utilisés. Ces outils permettent aux industriels de sécuriser un prix compétitif tout en finançant de nouvelles capacités renouvelables, et peuvent devenir l’un des leviers majeurs de la décarbonation s’ils sont portés de concert par les énergéticiens et l’État. Ce dernier pourrait d’ailleurs encourager, et le cas échéant encadrer davantage, le recours aux PPA afin de favoriser une convergence des industriels avec les objectifs nationaux de transition énergétique.
La réussite de cette trajectoire suppose aussi une lisibilité accrue des aides publiques. L’effet « stop & go » sur les subventions, qui fragilise la confiance, doit être évité au profit de mécanismes durables, prévisibles et conditionnés à des résultats quantifiables. Ainsi, la coordination entre les différents niveaux étatiques (État, régions, territoires industriels) doit être renforcée pour éviter les injonctions contradictoires et garantir une cohérence d’action.
Pour conclure, un simple respect des obligations légales ne permettra pas d’atteindre la neutralité carbone en France. Si le cadre réglementaire est désormais clair et contraignant, les freins économiques et organisationnels freinent encore sa mise en œuvre. Ainsi pour réussir cette transition, il est essentiel d’instaurer une stabilité réglementaire, des aides publiques prévisibles et des mécanismes de financement innovants comme les PPA.
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

Dans un contexte de transformation énergétique et réglementaire, les acteurs du secteur font face à de nombreux bouleversements, l’occasion de réinventer les modèles du secteur. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations numériques et dans leurs problématiques métiers pour en faire des leviers de performance, tout en alignant innovation et réalité opérationnelle.

Forts de nos multiples expériences, nous aidons les acteurs du secteur des Énergies et des Utilities à déployer des plans d’action concrets - refonte de SI, nouveaux services, business models innovants. En France comme en Belgique, notre expertise allie audace et pragmatisme pour des résultats mesurables.