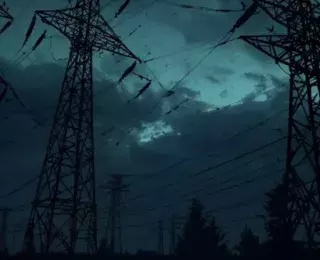Les objectifs de la décarbonatation sont- ils conciliables avec la justice sociale ?
La transition vers une économie bas-carbone est essentielle pour lutter contre le changement climatique, mais soulève des questions d’équité. Les politiques de décarbonation peuvent-elles garantir une justice sociale sans accroître les inégalités socio-économiques et territoriales ?
Etat des lieux sur les défis de la décarbonation
Les objectifs de neutralité carbone de la France (SNBC/planification écologique)
Depuis 2018, la France dispose d’une feuille de route pour réduire l’empreinte carbone des Français et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) permettrait de les atteindre via des objectifs sectoriels à court et moyen termes et grâce à l’allocation d’un budget pluriannuel de 50 milliards d’euros. Par ailleurs, la planification écologique (plan d’action mis en place en 2022 pour accélérer la transition écologique) apporte une démarche de territorialisation avec le lancement des COP régionales en 2023. Le but étant de mettre en cohérence les réalités locales avec la trajectoire nationale définie pour 2030.
En 2018, l'État français a introduit, via la transition énergétique pour la croissance verte, la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Cette loi fixe 2 objectifs à atteindre en 2050 : atteindre la neutralité carbone et réduire l’empreinte carbone des Français.
En plus de cette stratégie, la France s’est également dotée d’un plan d’action pour accélérer la transition écologique. La planification écologique en France est une stratégie gouvernementale visant à organiser et accélérer la transition écologique du pays tout en garantissant un développement économique et social soutenable. Elle repose sur une approche coordonnée entre l’État, les collectivités, les entreprises et la société civile pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cette planification a 6 grands objectifs :

Les chiffres sur la décarbonation en france
En 2022, les émissions françaises étaient de 410 millions de tonnes équivalent CO₂ (MtCO₂). Les plus gros émetteurs sont, sans surprise, les entreprises qui emettent 78 % des emission nationale.
Néanmoins, les efforts insufflés par l'État ont permis de suivre une tendance de baisse de long terme : depuis 1990, l'empreinte carbone totale a diminué de 13 %, (26 % par habitant), en tenant compte de l'augmentation de la population.
Le constat - augmentation de prix.
Néanmoins en parallèle, les prix des énergies ne cessent d'augmenter. Les facteurs géopolitiques, la raréfaction des ressources ou encore les déséquilibres d’offres et demandes viennent expliquer en partie cette hausse. A cela s’est ajouté : les politiques de décarbonation , qui viennent renforcer cette hausse… En effet, les énergies peu chères et carbonées sont fortement taxées, afin de tenir les objectifs de décarbonation. Par conséquent, ceci engendre, en complément des autres facteurs de l’inflation des prix de l'énergie, une perte du pouvoir d’achat aux ménages français.
Les difficultés pour concilier la décarbonation et la justice sociale
Cette hausse généralisée des coûts, bien qu’en partie liée à d’autres facteurs conjoncturels, révèle les tensions croissantes entre les objectifs climatiques et leur impact socio-économique : décarboner, oui, mais à quel prix pour les citoyens les plus fragiles ?
Inégalités économiques et territoriales de la décarbonation
La décarbonation est un objectif national, mais sa réussite dépendra de sa capacité à intégrer les réalités socio-économiques et territoriales des Français.
Certaines mesures, comme la taxation des énergies fossiles, les réglementations environnementales ou les normes de rénovation, génèrent des coûts particulièrement lourds pour les ménages modestes et les territoires fragiles. La hausse du prix des carburants ou du chauffage, encouragée par des mécanismes comme la taxe carbone, frappe ainsi de plein fouet les foyers précaires : les 10 % les plus pauvres sont 2,7 fois plus touchés, en proportion de leur revenu, que les 10 % les plus riches.
Cela s’explique par le fait que ces ménages consacrent déjà une part importante de leur budget à l’énergie et disposent de peu de ressources pour investir dans des alternatives bas-carbone (voitures électriques, travaux d’isolation…).
Les inégalités territoriales renforcent cet effet. En zone rurale ou périurbaine, où les transports en commun sont rares, la dépendance à la voiture individuelle est forte : 87% des français déclarent utiliser quotidiennement leur voiture en zone rurale contre 52% dans l’agglomération parisienne. Les restrictions sur les véhicules thermiques ou la hausse des carburants y sont donc particulièrement pénalisantes.
Par ailleurs, certaines régions industrielles, historiquement dépendantes de secteurs émetteurs de CO₂, risquent des pertes économiques majeures, si aucune politique de décarbonation comprenant des dispositifs de reconversion et de soutien à l’emploi n’est mise en place. À l’inverse, d’autres territoires tirent profit de la transition, renforçant leur attractivité grâce aux investissements dans les énergies renouvelables.
Des politiques publiques perfectibles, ces dispositifs qui creusent les écarts qu’ils prétendent réduire
Les inégalités créées par la transition énergétique ne se limitent pas seulement aux disparités d’accès aux infrastructures ; elles résultent aussi des modalités de mise en œuvre des politiques de décarbonation.
Certaines aides, pensées pour accélérer la décarbonation, se sont révélées inégalitaires dans leurs effets. C’est le cas de MaPrimeRénov’, dispositif d’aide à la rénovation énergétique. Si les subventions sont modulées en fonction des revenus, elles restent souvent insuffisantes pour couvrir l’intégralité des travaux. Surtout, la nécessité d’avancer les frais reste un frein majeur pour les ménages les plus modestes. Résultat : ces aides bénéficient principalement aux classes moyennes et aisées, plus solvables et mieux armées pour naviguer les démarches administratives.
Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) illustre d’autres limites. Pensé pour financer des travaux d’économies d’énergie, il a donné lieu à des dérives massives, en particulier autour des offres d’isolation à 1 euro. Malfaçons, fraudes, pratiques commerciales abusives ; de nombreux ménages vulnérables en ont fait les frais, contribuant à fragiliser la confiance envers les aides publiques.
Enfin, ces dispositifs sont d’autant moins accessibles dans les zones rurales ou périurbaines, où les artisans qualifiés manquent et où les services d’accompagnement sont rares. Là où les métropoles profitent d’alternatives bas-carbone développées (transports collectifs, infrastructures), nombre de territoires restent exclus de la transition et peinent à en saisir les opportunités.
Insuffisance des dispositifs de solidarité et d’accompagnement
Assurer une transition bas-carbone socialement soutenable suppose de renforcer les dispositifs de soutien en direction des ménages et territoires les plus exposés.
Des mécanismes de redistribution plus ambitieux, comme des aides directes à la mobilité durable ou des incitations à l'efficacité énergétique, pourraient atténuer les effets régressifs des politiques climatiques. Aides directes à la mobilité durable, incitations à la rénovation énergétique ou chèques énergie mieux ciblés sont autant de leviers identifiés par le Haut Conseil pour le Climat (HCC, 2023) pour compenser les surcoûts de la transition pour les plus modestes.
Mais au-delà des mesures financières, l’efficacité de la transition passe par une meilleure gouvernance locale. L’intégration des collectivités et des acteurs de terrain est essentielle pour adapter les dispositifs nationaux aux réalités de chaque territoire, comme le souligne France Stratégie (2022).
En définitive, assurer une transition juste implique de repenser les politiques publiques sous l’angle de la solidarité interterritoriale et sociale. La redistribution des investissements, le développement des compétences et l’accompagnement renforcé des mutations économiques seront des leviers essentiels pour éviter que la décarbonation ne creuse les fractures existantes.
Solidarité interterritoriale : La clé pour une décarbonation juste et efficace ?
Pour être juste, la décarbonation doit tenir compte des réalités locales. Sans la prise en compte des disparités économiques, sociales et environnementales, la décarbonation risque de devenir un facteur de fragilisation pour des territoires qui sont déjà vulnérables.
La difficulté majeure réside dans la prise en compte des enjeux locaux dans les stratégies nationales. L’atteinte de la neutralité carbone demande une transition rapide alors qu’il existe des territoires dont l’économie est essentiellement structurée autour des énergies fossiles, leur production étant fortement localisée. Ainsi, les territoires industriels seront plus fortement touchés par les effets négatifs de la décarbonation : la Dares a identifié 49 métiers industriels sur 80 recensés en déséquilibre à l’horizon 2030. Les politiques nationales doivent donc s’intéresser aux conséquences de la décarbonation sur les territoires et un accompagnement est nécessaire, notamment à travers des politiques conciliant décarbonation et renforcement des tissus productifs sur les territoires.
Une analyse sur les spécificités géographiques de chaque territoire permettrait non seulement de limiter les impacts négatifs de la décarbonation, mais également d’attirer des nouveaux investissements et de créer des nouveaux emplois. Le rôle des territoires est donc essentiel pour la décarbonation, surtout lorsque l’échelle intercommunale facilite la collaboration entre les différents acteurs concernés (syndicats, entreprises, collectivités, citoyens, etc).
À moyen et long termes, les effets sur l’emploi dépendront de la capacité à les anticiper et à faciliter la transition et la formation de la main-d'œuvre vers des secteurs porteurs liés à l’économie verte. Pour accompagner cette transformation, une redistribution territoriale de l’emploi industriel est nécessaire. Ainsi, l’OFATE (Office Franco-Allemand pour la Transition Énergétique) estime que l’emploi va croître dans presque toutes les régions dans le secteur des énergies renouvelables. De plus, une étude de The Shift Project montre que la territorialisation des enjeux de décarbonation permettrait de mieux répondre aux défis des futurs emplois et rendre l’industrie plus résiliente face à la concurrence internationale et aux risques, participant ainsi à la diversification de l’économie et à la résilience locale. Par conséquent, orienter les investissements vers des régions dépendantes des secteurs conventionnels serait une manière de contribuer à la transition juste, d’autant plus si ces investissements profitent aux communautés locales.
Projets de territoire : moteurs d’une décarbonation équitable et résiliente
Aujourd’hui, s’il existe encore peu d’outils pleinement structurés pour concilier impact social et environnemental, des coopérations territoriales et des synergies entre acteurs publics et privés se consolident autour des “projets de territoire”. Ces complémentarités et mutualisations de ressources représentent des leviers puissants pour avancer vers une transition à la fois écologique et équitable. À titre d’exemple, la transition énergétique de Brest - un territoire qui dispose de peu de moyens de production énergétique locale et dont l’approvisionnement énergétique est fragile - s’appuie sur des partenariats noués avec des collectivités rurales pour valoriser et développer la production d’énergies renouvelables. Cette dynamique montre qu’une décarbonation socialement juste est non seulement possible, mais aussi porteuse de résilience collective.
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

Dans un contexte de transformation énergétique et réglementaire, les acteurs du secteur font face à de nombreux bouleversements, l’occasion de réinventer les modèles du secteur. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations numériques et dans leurs problématiques métiers pour en faire des leviers de performance, tout en alignant innovation et réalité opérationnelle.

Forts de nos multiples expériences, nous aidons les acteurs du secteur des Énergies et des Utilities à déployer des plans d’action concrets - refonte de SI, nouveaux services, business models innovants. En France comme en Belgique, notre expertise allie audace et pragmatisme pour des résultats mesurables.