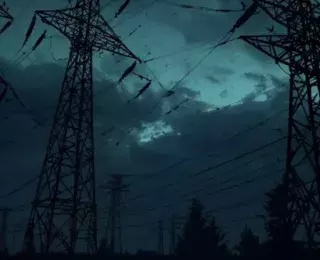Label vert européen : une nouvelle orientation des investissements bancaires

A la publication récente du 2ème volet du groupe d’experts bénévoles du GIEC démontrant notamment l’adaptation indispensable des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique, nous pouvons nous interroger sur les effets possibles de la création du label vert européen.
Une taxonomie verte ambiguë
Le 2 février dernier, la commission européenne a annoncé la création d’un label « vert » à destination des investisseurs en incluant dans la liste des énergies “durables” les filières nucléaire et gaz naturel fossile, provoquant la colère des ONG et de certains pays européens dont l’Autriche et le Luxembourg, qui menacent de porter plainte auprès du parlement européen.
Cette décision s’intègre dans les débats menés depuis 2018 autour de la « taxonomie verte », dont l’objectif est d’apporter des critères précis pour identifier les activités économiques dites vertes, c’est-à-dire celles dont les émissions de CO2 sont situées sous un certain seuil, montrant qu’elles participent ainsi à l’évolution positive du climat.
Le choix d’introduire ces deux technologies dans la « taxonomie verte », relève donc plutôt des activités permettant d’atténuer le réchauffement climatique, et seraient à ce titre des solutions transitoires.
Dans cette taxonomie, les critères proposés pour les centrales au gaz seraient de respecter à terme le seuil de 100 g de CO2/kWh pour tout permis de construire obtenu avant le 1er janvier 2031. Les technologies actuelles ne permettant pas d’atteindre ce seuil, il est relevé à 270 g de CO2/kWh pour les centrales obtenant un permis avant 2030 lorsque celles-ci viennent en remplacement de moyens thermiques plus polluants encore. A titre de comparaison, le facteur d’émission moyen pour le gaz naturel français atteignait 406 g de CO2/kWh en 2020.
Pour les centrales nucléaires, les risques accompagnant cette technologie, et les difficultés à gérer les déchets n’en font pas une solution durable. Les critères retenus dans la taxonomie sont l’obtention d’un permis de construire avant 2045, et le prolongement des réacteurs déjà en place qui devra être lancé avant 2040.
Une aide sans contrainte pour les investisseurs
Du côté des investisseurs, il ne faut pas oublier que la COP26 de Glasgow a fait émerger sous l’impulsion de l’ONU une alliance mondiale qui rassemble les initiatives existantes et nouvelles en matière de financement zéro, la GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), également connue sous le nom de Net Zero Alliance. Les signataires de cette alliance, de l’ordre de 450 entreprises au capital de 130 trillions de dollars, doivent se fixer des objectifs intermédiaires et à long terme, alignés sur la science, pour atteindre l’objectif de zéro émission nette au plus tard en 2050.
Grâce à cette taxonomie verte, tous ces investisseurs y verront donc plus clair sur les domaines d’activités dans lesquels ils pourront apporter leur financement, avec la reconnaissance d’un investissement qualifié de « durable ». Le risque est néanmoins qu’une partie des investissements ne se tourne plus vers les énergies renouvelables, mais vers le nucléaire et le gaz. Cette taxonomie reste cependant une incitation à investir dans ces énergies en imposant plus de transparence mais n’impose aucune contrainte.
Les annonces présidentielles françaises alignées
Lors du discours de Belfort le 10 février 2022, le président français Emmanuel Macron a annoncé notamment une série de mesures concernant le nucléaire avec un programme EPR2 : la création de 6 nouvelles centrales nucléaires de type EPR de seconde génération (bénéficiant du retour d’expérience des premières générations d’EPR construite ou en cours de construction), entre 2035 et 2045, pour un budget estimé de 50 à 60 Md€ sur 30 ans, pour 25 GW de capacité.
En complément, une option sur 8 centrales EPR2 supplémentaires à l’étude d’ici 2050, portant le coût total à plus de 100 Md€. Il annonce également que la prolongation au-delà de 50 ans des centrales existantes sera demandée progressivement, contrairement aux orientations inscrites dans la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 2019-2028 adoptée en 2020 prévoyant l’arrêt de 12 réacteurs d’ici 2035. Tout cela, sans abandonner le programme de création de petits réacteurs nucléaires, les SMR (small modular reactors), annoncé dans le cadre du plan France 2030 et dont l’Etat annonce le financement à hauteur d’1 Md€, plus 500 millions apportés par EDF.
Les modalités de financement de ce nouveau programme nucléaire EPR2 par l’Etat n’est pas précisé, au-delà d’une simple qualification de “montant significatif”. Or, au vu des dizaines de milliards d’euros estimés, ni l’Etat français, ni EDF n’ont les moyens de financer seuls. Ce plan s’inscrit donc parfaitement dans la nouvelle taxonomie verte, tant dans le respect des critères proposés que dans le timing de l’annonce.
La guerre en Ukraine, un catalyseur du label vert du gaz pour limiter la dépendance au gaz russe ?
Le conflit ukrainien met en exergue la forte dépendance de l’Europe face à l’approvisionnement en gaz russe, située en moyenne à 40% mais avec de fortes disparités (17% pour la France, 55% pour l’Allemagne et 100% pour la Pologne). Afin de limiter cette dépendance, l’Allemagne va construire deux nouveaux terminaux méthaniers (mise en service prévue pour 2026), afin de pouvoir importer par voie maritime du gaz naturel liquéfié et limiter ainsi sa dépendance au gaz russe. Diversifier son approvisionnement est sans doute une étape importante pour pouvoir convaincre à terme les investisseurs de financer la construction des centrales au gaz qui lui permettront de décarboner sa production et se libérer progressivement de l’utilisation du charbon.
Cependant, les offres alternatives au gaz russe ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins de tous les pays européens. La guerre en Ukraine pourrait donc aussi remettre sur la balance le développement des énergies renouvelables, plus rapides à déployer, et contribuer à leur essor au détriment des nouveaux labels verts, même si la tendance qui se profile est plutôt le recours au charbon notamment en Italie et en Allemagne.
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

Dans un contexte de transformation énergétique et réglementaire, les acteurs du secteur font face à de nombreux bouleversements, l’occasion de réinventer les modèles du secteur. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations numériques et dans leurs problématiques métiers pour en faire des leviers de performance, tout en alignant innovation et réalité opérationnelle.