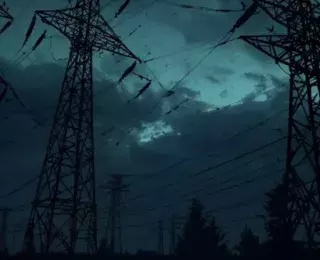Décarbonation du chauffage résidentiel : Enjeux, solutions et perspectives

La loi sur l’énergie et le climat de 2019 fixe l’objectif de neutralité carbone en France d'ici 2050 avec une réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030. Actuellement, le chauffage résidentiel représente plus de 44 % de la consommation énergétique nationale et est majoritairement alimenté par des sources fossiles, notamment le gaz. La transition vers une meilleure efficacité énergétique et l'utilisation croissante des énergies renouvelables (ENR) pour le chauffage résidentiel sont donc devenues indispensables.
Comprendre la décarbonation du chauffage résidentiel
Qu'est-ce que la décarbonation ?
La décarbonation est le processus qui vise à diminuer les émissions de CO₂ et d'autres gaz à effet de serre (GES) liés aux activités humaines. Le but principal est de parvenir à des niveaux d'émissions en adéquation avec les engagements internationaux, comme l'Accord de Paris de 2015, qui cherchent à limiter le dérèglement climatique. Elle implique la transition vers des sources d'énergie moins polluantes et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans divers secteurs, notamment l'industrie, le transport et le chauffage résidentiel.
État des lieux du chauffage résidentiel en France / Europe
La situation du chauffage résidentiel en France et en Europe révèle une utilisation variée des systèmes de chauffage. Environ 40 % des logements français sont chauffés au gaz, tandis que le fioul (combustible dérivé du pétrole) est encore utilisé dans environ 10 % des cas. L'électricité est également largement utilisée, avec environ 35 % des installations, souvent sous forme de radiateurs électriques. Les ENR, bien que moins répandues, se développent, notamment avec les pompes à chaleur et les chaudières à biomasse, qui représentent environ 10 % des installations.
Le bilan carbone de ces différents systèmes de chauffage varie considérablement. Le fioul et le gaz ont un impact carbone élevé, alors que l'électricité peut être moins polluante selon son origine, surtout si elle provient de sources renouvelables ou nucléaires. Les réglementations en vigueur, comme la réglementation thermique RT 2012 en France, imposent des normes d'efficacité énergétique pour les constructions neuves et les rénovations. De plus, la France vise une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en comparaison avec ses émissions de 1990, en mettant l'accent sur l'amélioration des systèmes de chauffage existants.
Les solutions de décarbonation
Afin d’optimiser le chauffage des français, le gouvernement souhaite remplacer d’ici 2030 75% des chaudières au fioul et 25% des chaudières à gaz. Ces dernières seront retirées au profit de solutions de chauffage décarbonées telles que les pompes à chaleur et autres dispositifs reposant sur les ENR.
Les modes de chauffage grâce aux énergies renouvelables
La pompe à chaleur (PAC) est un système thermodynamique qui récupère les calories disponibles dans l’air, le sol ou les nappes phréatiques, afin de chauffer (ou refroidir) une surface. La PAC puise l’énergie thermique d’une source froide pour le transférer vers une source chaude via un fluide frigorigène. La température du gaz récolté augmente grâce à la haute pression d’un compresseur, avant d’être diffusée par ventilation ou circuit d’eau chaude pour chauffer l’espace.
La PAC a recours à l'aérothermie ou la géothermie (l’énergie thermique est respectivement puisée dans l’air ou le sol). L’efficacité énergétique de la PAC permettrait de réaliser des économies annuelles non négligeables (pouvant aller de 450€ à 1 200€) par rapport au chauffage au gaz et chaudière au fioul. Malgré les aides gouvernementales disponibles, l'acquisition reste coûteuse avec un coût moyen avoisinant les 15 000€ pour une pompe à chaleur air/eau. En comparaison, le prix d’installation d’une chaudière à gaz varie entre 500€ et 1 500€. Par ailleurs, le gouvernement se fixe un objectif de production d’un million de PAC d’ici 2027, ce qui confirme le potentiel de pompe à chaleur comme un levier efficace de décarbonation du chauffage.
Le chauffage solaire est une autre alternative aux modes de chauffage reposant sur les énergies fossiles. La chaleur du rayonnement du soleil est récupérée via des panneaux solaires installés sur le toit d’un bâtiment. Un fluide caloporteur permet ensuite de disposer d’une eau de chauffage ou sanitaire.
Leviers pour décarboner le réseau de chaleur
En 2023, le réseau de chaleur se décarbone avec une part d’énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) de 65% (contre 37,6% en 2012), preuve d’une sortie progressive des énergies fossiles. L’efficacité énergétique et l’optimisation du réseau de chaleur nécessitent une vision des usages du chauffage. Les collectivités locales doivent se doter des clés pour anticiper l’évolution du réseau de chaleur et l’optimiser.
L’enquête annuelle de réseaux de chaleur et de froid 2024, réalisée par la FEDENE (fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement) met notamment en lumière la production d’ENR&R par zones géographiques en France dans le réseau de chaleur. Ainsi, la récupération de chaleur industrielle est davantage observée dans le Grand Est, qui est une zone à forte activité industrielle. En effet l’énergie fatale y est produite en grande quantité et peut être valorisée dans le réseau de chaleur. Cette visibilité des sources d’énergie dans le réseau de chaleur (biomasse, géothermie, solaire thermique, UVE, énergie fatale) permet d’adapter les raccordements au réseau de chaleur.
Les politiques et initiatives de soutien
Réglementations et incitations gouvernementales
En France, MaPrimeRénov’ est un dispositif subventionnant les ménages souhaitant remplacer leurs systèmes de chauffage polluants par des équipements plus écologiques, tels que des pompes à chaleur ou des chaudières biomasse. En complément, les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et l’Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) permettent de financer les travaux de rénovation énergétique, incitant les consommateurs à investir dans des technologies vertes. Ces dispositifs, combinés à l’interdiction progressive des chaudières au fioul et à gaz dans les bâtiments neufs imposée par la RE2020, orientent clairement le marché vers des alternatives renouvelables.
Au niveau européen, la Directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) fixe des objectifs ambitieux, tels que la rénovation des logements les plus énergivores d’ici 2030 et l’obligation de construire des bâtiments "zéro émission" dès 2030. Les collectivités locales jouent également un rôle essentiel en proposant des aides complémentaires et en investissant dans des réseaux de chaleur alimentés par des ENR.
Sensibilisation et accompagnement des ménages
Pour réussir la transition énergétique, les ménages doivent être informés et accompagnés dans leurs démarches. En effet, bien que les incitations financières soient attractives, elles nécessitent souvent une compréhension technique et administrative qui peut décourager certains foyers.
Des campagnes de sensibilisation, comme celles menées par France Rénov’, offrent des conseils personnalisés et gratuits pour guider les propriétaires vers des solutions adaptées à leurs besoins. Ce portail centralise également les informations sur les aides disponibles, facilitant les démarches administratives.
La formation des professionnels du bâtiment est un autre levier crucial. Les artisans labellisés Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) bénéficient de programmes spécifiques pour maîtriser les technologies vertes et conseiller efficacement leurs clients. Cette montée en compétences contribue à garantir la qualité des rénovations tout en renforçant la confiance des ménages.
En 2021 le chauffage résidentiel provenait principalement d’énergie fossile, avec 127,6 TWh PCS de gaz naturel injecté pour chauffer les logements. Le réseau de chaleur permettrait de décarboner le chauffage résidentiel grâce à l’injection d’ENR&R. En 2023, 53% de la chaleur provenant de ce réseau est livrée pour un usage résidentiel. Le recours aux réseaux de chaleur pour les secteurs industriel et tertiaire permettrait également de limiter les émissions de GES. Par ailleurs, la filière d’unités de valorisation énergétique offre une piste prometteuse. Leur inclusion dans le dispositif de quota carbone est en cours d'évaluation par la Commission Européenne.
Bien que le recours aux ENR ait progressé, l’instabilité réglementaire freine les investissements, notamment en raison de la baisse de budget du fond de chaleur.
Avec des objectifs nationaux situés entre 31 et 36 TWh de chaleur renouvelable et de récupération en 2028, il est essentiel de continuer de soutenir la filière via un cadre stable, des subventions et un accompagnement régional.
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

Dans un contexte de transformation énergétique et réglementaire, les acteurs du secteur font face à de nombreux bouleversements, l’occasion de réinventer les modèles du secteur. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations numériques et dans leurs problématiques métiers pour en faire des leviers de performance, tout en alignant innovation et réalité opérationnelle.

Forts de nos multiples expériences, nous aidons les acteurs du secteur des Énergies et des Utilities à déployer des plans d’action concrets - refonte de SI, nouveaux services, business models innovants. En France comme en Belgique, notre expertise allie audace et pragmatisme pour des résultats mesurables.