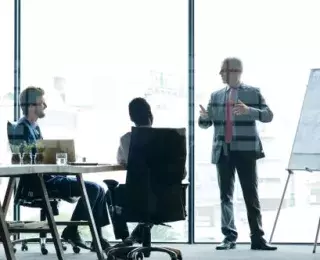Conseil en organisation : allier méthode et jugement pour réussir
Le conseil en organisation s'appuie sur des frameworks et méthodes éprouvés (SWOT, Lean, ADKAR) pour rassurer et structurer les transformations. Mais cette obsession de la méthode peut devenir une faiblesse, créant des diagnostics hors-sol et bridant le jugement. Cet article analyse les limites d'une approche trop rigide et propose de rééquilibrer méthode et discernement pour un conseil plus contextuel et un pilotage de projet plus efficace.
I. Le règne des frameworks : rassurants mais limitants
La prolifération des frameworks, méthodologies et démarches propriétaires a accompagné la professionnalisation du conseil. SWOT, PESTEL, McKinsey 7S, Business Model Canvas, Kotter, ADKAR, Lean Six Sigma, Design Thinking, Operating Models… Ces outils sont désormais omniprésents dans les supports de diagnostic, les phases de cadrage, les ateliers de co-construction ou encore les plans de transformation.
Leur rôle est évident : ils permettent de structurer la pensée, de faciliter l’appropriation par les parties prenantes, de normaliser la production. Dans des environnements instables, ils rassurent les décideurs et apportent un cadre. Ils sont particulièrement utiles dans des contextes fortement industrialisés (fusions, standardisation de processus, déploiements SI) ou réglementés (compliance, contrôle interne).
Mais cette force est aussi leur faiblesse. Trop souvent, ces cadres deviennent prescriptifs : on plaque la méthode sur le réel sans prendre le temps de l’analyser. L’outil devient un filtre qui limite la lecture de la situation, plutôt qu’un révélateur de ses complexités.
Limite systémique : comme l’a montré Michel Crozier dès les années 60 dans Le phénomène bureaucratique, les règles formelles dans les organisations ne permettent pas de saisir les jeux d’acteurs, les marges de liberté et les logiques d’adaptation informelles. Les frameworks, en cherchant à tout réguler, sous-estiment ces logiques de contournement, pourtant essentielles à la vie réelle des organisations.
II. Les dérives d’une méthode déconnectée du terrain
Derrière l’outil, c’est parfois une posture qui pose problème : celle d’un conseil qui regarde l’organisation comme un objet à transformer de l’extérieur, à coups de matrices et de benchmark. Une approche qui, si elle n’est pas contrebalancée par l’observation fine du terrain, produit des livrables élégants mais inaptes à créer une dynamique réelle.
Trois dérives sont fréquentes :
- Le primat de la forme sur le fond : des livrables parfaitement mis en page, normés, avec des indicateurs, des KPI et des feuilles de route… mais construits sans véritable immersion, sans saisir les habitudes, les résistances, les récits organisationnels sous-jacents
- Le biais de projection : on projette un modèle théorique sur une organisation sans vérifier s’il est culturellement et opérationnellement transposable
- Le court-circuitage du dialogue : le temps passé à appliquer la méthode est parfois pris sur le temps d’écoute, d’enquête, de confrontation des points de vue
Ces dérives se retrouvent aussi dans les retours terrain : frustration de certains collaborateurs face à des diagnostics « hors sol », scepticisme des managers sur des benchmarks déconnectés, ou même lassitude des jeunes consultants confrontés à des approches «copier/coller» peu contextualisées. Ces signaux faibles doivent nous alerter : le conseil perd de son pouvoir de transformation s’il ne s’ancre pas dans la complexité réelle des organisations.
Dans leur ouvrage L’ingénierie du changement (Le Moigne et Le Duff, 2001), les auteurs insistent sur la nécessité de “co-construire le changement avec les acteurs, et non pour eux”. L’absence de cette co-construction, souvent négligée par excès de méthode, est une cause majeure d’échec des transformations.
III. Pour une posture plus réflexive et contextuelle du conseil
Face à ces dérives, il ne s’agit pas de jeter la méthode, mais de la remettre à sa juste place : un moyen, non une finalité. Ce qui doit primer, c’est la capacité du consultant à porter une posture réflexive, sensible, capable de lire les signaux faibles et de s’ajuster aux dynamiques locales.
Au-delà de l’usage des outils, la valeur du conseil repose sur ce que l’on appelle le discernement, cette capacité à comprendre l’organisation dans sa réalité vécue, avec ses paradoxes, ses tensions et ses trajectoires.
Ce retour à une posture d’analyse et non d’application suppose plusieurs inflexions :
- Faire de l’enquête un préalable non négociable : avant d’appliquer une méthode, il faut comprendre le territoire organisationnel. Cela suppose des entretiens qualitatifs, des observations, une analyse des tensions, des imaginaires collectifs, des trajectoires passées de transformation
- Mobiliser les méthodes comme des ressources adaptables : une matrice n’est pas un plan à suivre, mais une aide à penser. Le bon consultant sait adapter ou suspendre ses outils
- Travailler la réflexivité dans les équipes de conseil : interroger sa propre manière de faire, confronter les grilles de lecture, mettre en débat les conclusions tirées. Cela renforce l’humilité et la qualité du jugement
- Développer une culture du “situé” : comme l’enseigne la sociologie pragmatique (cf. Luc Boltanski, Laurent Thévenot), toute action doit être comprise dans son contexte d’énonciation. Appliquer un même plan à deux organisations différentes n’a pas de sens si l’on ne tient pas compte des histoires, des identités collectives, des rapports au changement
Redonner sa place au jugement professionnel, c’est cultiver une capacité à décider sans toujours se reposer sur un canevas. Cela implique de former les consultants à :
- la lecture des signaux faibles et des dynamiques relationnelles
- l’analyse qualitative et contextuelle, en complément des indicateurs
- la réflexivité : capacité à questionner ses propres biais, ses outils et ses hypothèses. Ce jugement ne s’improvise pas. Il se construit dans la durée, par la supervision, le mentorat, les retours d’expérience croisés, et une culture du doute fertile.
Le conseil en organisation a beaucoup gagné en professionnalisation grâce aux méthodes, mais ce progrès technique ne doit pas se faire au prix de la perte du discernement.
À force de protocoliser l’intervention, on prend le risque d’un conseil désincarné, technocratique, qui passe à côté de ce qui fait la richesse des organisations : leur complexité humaine, leurs dynamiques implicites, leurs paradoxes fertiles. Face à cette réalité, la posture du consultant doit évoluer : de l’expert de la méthode à l’analyste du contexte, du producteur de solutions à l’animateur de compréhension.
Un conseil utile aujourd’hui est un conseil capable d’évoluer dans l'ambiguïté, de dialoguer avec l’informel, de penser avec et non pour les organisations. Cela demande du temps, de l’humilité, et surtout, un retour au cœur du métier : l’écoute, le sens du terrain et le jugement professionnel.
En ce sens, repenser la posture du consultant, c’est aussi repenser la manière dont les cabinets forment, évaluent et valorisent les parcours. Il ne s’agit plus seulement de produire des livrables solides, mais de former des praticiens du sens, capables d’ouvrir l’espace de discussion, d’intégrer la part d’incertitude, et de faire émerger des solutions pertinentes dans chaque contexte singulier.
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

A travers son savoir-faire et ses multiples expertises, mc2i accompagne ses clients sur l'ensemble de ses projets de Transformation. Customer et user-centric, mc2i propose une personnalisation de ses services.