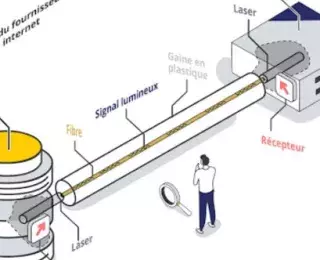Contenus audiovisuels sportifs : entre piratage et riposte
En 2022, l’urgence d’adapter la régulation audiovisuelle face à la hausse du piratage, notamment dans le sport, était déjà présente. Trois ans plus tard, la pression reste intacte, mais les réponses institutionnelles ont évolué. L’ARCOM a depuis renforcé ses dispositifs de lutte contre le piratage, avec un accent particulier sur le live-streaming illicite.
Ce nouveau bilan fait le point sur les usages, évalue l’efficacité des politiques mises en œuvre depuis 2022 et présente les risques toujours présents sur le marché.
Usages numériques en mouvement, piratage en expansion
L’année dernière, la consommation illicite de sport en direct reste préoccupante puisque 62% des français regardent du sport en direct, dont 18% par des canaux illégaux. (cf. slide 7).
La consommation illégale concerne avant tout des “hyper-consommateurs” de contenus audiovisuel sportif, qui, paradoxalement, sont aussi très investis dans l’offre légale : 60 % d’entre eux sont pour autant abonnés à une plateforme légale ET regardent du sport de manière illicite. (cf. slide 21).
Concernant les usages, Le live streaming demeure le mode d’accès illicite le plus répandu, suivi par l’IPTV, en forte progression : 16 % des consommateurs passent par des sites de streaming illégaux contre 12 % par des solutions d’IPTV. (cf. slide 7).
La progression de l’IPTV ne cesse de croître d’années en années et les usages se renouvellent rapidement, 41 % des utilisateurs de ces services déclarent y avoir recours depuis moins d’un an, contre seulement 26 % en 2023 (cf. slide 10), signe d’un renouvellement rapide et d’une attractivité croissante.
La pression économique reste néanmoins considérable, avec un manque à gagner de plus de 1,5 milliard d’euros (cf. slide 70). En comparaison avec 2019, il s’agit de +280 millions d’euros de manque à gagner (cf. slide 74), lié à l’assiduité plus forte des consommateurs de contenus illicites. Face à ces pratiques, les mesures de blocage commencent toutefois à montrer leur efficacité.
ARCOM face au piratage audiovisuel : quel bilan depuis 2019 ?
L’ARCOM a renforcé ses moyens juridiques contre les retransmissions sportives illégales. Le Code du Sport - Article L333-10 - prévoit désormais un dispositif permettant aux ayants droits, c’est-à-dire aux fédérations, ligues et diffuseurs) de saisir le juge pour obtenir des mesures de blocages temporaires, applicables à chaque journée de compétition, y compris pour des sites non identifiés à l’avance.
Ainsi depuis 2022, 8 505 noms de domaine ont été bloqués sur notification par l’ARCOM dont 3 787 sur l'année 2024 (+146% par rapport à 2023). Sur quatre ans, cela représente un total de 10 006 blocages, par décision judiciaire et notification de l’ARCOM.
En parallèle à ces mesures, une campagne de sensibilisation intitulée "Protège ton sport", menée avec l’APPS depuis juin 2024, vise à alerter le public sur les conséquences du piratage et à promouvoir la valeur de l’offre légale.
Plus récemment, la jurisprudence a également appuyé cette dynamique. Cette année, Canal+ a obtenu le 18 juillet devant le tribunal judiciaire des injonctions ordonnant à plusieurs services VPN (NordVPN, Surfshark…) de bloquer l’accès aux contenus sportifs diffusés illégalement, considérant ces VPN comme étant des “intermédiaires techniques responsables de la diffusion pirate”.
Les causes structurelles de la persistance du piratage audiovisuelle sportif
Malgré les efforts de régulation de l’ARCOM et les progrès en matière de blocages, la fragmentation de l’offre légale et la hausse des prix continuent de favoriser le recours aux canaux illicites.
D’un côté, l’accès aux compétitions sportives reste éparpillé entre de multiples diffuseurs : Canal+, beIN Sports, Eurosport, DAZN, RMC Sport, Amazon Prime Video, ou encore Apple TV se partagent les droits, obligeant les consommateurs à multiplier les abonnements pour suivre plusieurs disciplines. Cette dispersion complexifie l’expérience utilisateur et augmente significativement le coût d’accès légal aux événements sportifs.
De l’autre, le prix moyen des abonnements audiovisuels ne cesse de croître. Le panier moyen mensuel des offres de vidéo à la demande (VàDA) est passé de 8,40 € en 2019 à 11,70 € en 2023. (cf. slide 31).
À titre d’exemple, le football, discipline la plus touchée par la consommation illégale, avec 12 % de ses spectateurs de la ligue 1 utilisant des canaux illicites (cf. slide 12). La Ligue 1 de football officialise donc la création de sa chaîne avec un abonnement à 14,99 euros par mois comportant huit des neuf matchs de chaque journée de Ligue 1 à suivre sur la plateforme, le reste des droits étant détenus par BEin jusqu’à la fin de la saison.
La fragmentation de l’offre et l’inflation du prix des plateformes alimentent une certaine frustration chez les consommateurs.
Si une majorité reste fidèle aux offres légales, beaucoup d’« hyper-consommateurs », déjà abonnés à plusieurs services payants, se tournent vers le piratage pour compléter leur accès. Le piratage apparaît ainsi moins comme un simple contournement que comme une réponse à une offre légale jugée trop morcelée et trop chère.
Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

Au travers d’une démarche design complète, mc2i accompagne ses clients dans la création d’expériences utilisateurs et solutions digitales adaptées aux besoins, simples et intuitives.